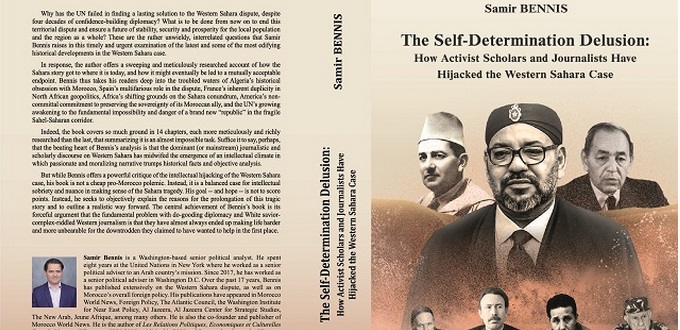(Billet 1087) – Entre les NEETs et le gouvernement, un profond conflit de génération
Il fallait s’y attendre… ce qu’on a appelé la grande évasion, ou seulement la grande tentative, de Fnideq, avait des raisons et des ressorts qu’on a peut-être minorés. Au-delà du NEEtisme que personne ne conteste et qui est en lui-même source d’inquiétude pour le royaume, c’est le profil de quantité de jeunes qui ont essayé de partir qui attire l’attention. Il s’agit d’un conflit de génération d’un côté, et d’un manque de compréhension du gouvernement, de lautre.
En effet, nombre de jeunes de Fnideq ne sont pas des NEETs, puisqu’ils sont formés, éduqués et même en situation d’emploi. Le problème est ailleurs, le problème est l’emploi, le problème est le salaire. Depuis des décennies, nous entendons nos gouvernements respectifs s’extasier et s’émouvoir devant quelques dizaines de milliers de postes d’emploi créés ou pourvus ; bruyants hourras et autocongratulations de circonstance. Depuis des décennies aussi, nous entendons nos gouvernements se pâmer devant les relèvements des salaires minimums, et le gouvernement Akhannouch ne déroge pas à la règle ; il a augmenté le SMIG, et c’est vrai.
Mais qui est ce jeune marocain d’aujourd’hui qui serait accompli, heureux, enthousiaste en travaillant avec un salaire mensuel de 3.000, 4.000 ou même 6.000 DH ? Les jeunes d’aujourd’hui, appartenant à la génération Z, sont connectés au monde, ultrabranchés sur leur environnement, animés par des pulsions différentes que celles de leurs aînés. Ainsi, un « ancien » percevant un revenu de quelques milliers de DH s’en accommodait, trouvait sa consolation dans les hamdoullah et mesurait sa chance d’avoir trouvé un travail par rapport aux autres dont ce n’était pas le cas. Il y avait alors moins de tentations, plus de résignation. Et ce n’est plus le cas aujourd’hui.
Les jeunes s’identifient aux influenceurs dont c’est le rôle, aux innombrables et très éclectiques stars dont c’est le but. Ils veulent travailler différemment, modérément, ils veulent se distraire, vivre… et non plus survivre comme ils avaient le sentiment que leurs parents faisaient.
Dans la troupe de près de 4.000 jeunes qui avaient essayé de franchir les barrières de Ceuta, il y avait des ouvriers d’usines, des employés de bureau qui, insatisfaits de leurs sorts, avaient ce mot à la bouche : « nriski », prêts à risquer leurs vies, leurs existences, leurs situations, même précaires, pour « sortir ». Au Maroc, dans le langage courant, quand quelqu’un part à l’étranger, on dit qu’il est « sorti » et même l’étranger est nommé « al kharij », avec la même racine que sortir. Un jeune Marocain, talentueux et diplômé, « sorti » récemment du pays et basé désormais en Espagne, qu’on interrogeait sur son éventuel retour au pays, répondait : « Le Maroc, c’est comme la famille, on l’aime mais il faut mettre un peu de distance avec elle » (lmaghrib fou9 rassi, walakin bhal m3a lfamila, tissa3 meziane »).
De quoi cela est-il le nom ? D’un puissant malaise et d’un profond mal-être de tous ces jeunes qui voient de quoi est fait le monde, et de quoi ils sont privés. L’ostentation qui les entoure les éprouve et les étouffe ; ils ont les mêmes sources d’informations que leurs congénères d’âge qui ont plus de ressources, qui étalent leurs richesses, qui affichent leur joie de vivre. Les
lieux d’opulence prolifèrent, les voitures rutilantes se multiplient, l’argent est roi et les signes extérieurs d’opulence deviennent la règle pour la classification sociale des uns et des autres.
Et ainsi, les manifestations d’humeur et les manifestations tout court sont de plus en fréquentes, les grèves sont partout et partout la même revendication : vivre mieux. Pas survivre ou seulement travailler, mais bien vivre et travailler décemment . Les étudiants en médecine réclament plus d’argent, les juristes aussi, auxquels se joignent les fonctionnaires des collectivités territoriales ou les cadres de la santé. Ils sont tous jeunes, ils sont tous épris de la vie, et leur attachement à leur pays est aujourd’hui moins fort que leur volonté de vivre dans leur temps.
Le problème aujourd’hui au Maroc n’est pas de procurer du travail, mais du travail valorisant. Les jeunes d’aujourd’hui ne réclament plus que du travail, mais les conditions qui vont avec (environnement, salaire, mode de gestion…). Et c’est ce que le gouvernement Akhannouch, et avec lui l'ensemble de la classe politique, n’ont pas compris et ne semblent pas être en mesure de comprendre. Questionné sur le taux de chômage en hausse (légère certes mais hausse quand même), le ministre de l’Emploi Younes Sekkouri y voit, dans une savante trituration de chiffres, « un signe d’espoir » de la population qui rechercherait plus activement du travail… Quant au chef du gouvernement lui-même, il évacue la question du chômage en en imputant la responsabilité au… ciel ! S’il pleut, le taux de chômage reviendra à des niveaux habituels, sinon, et bien…
C’est tout ? Même McKinsey n’a pas trouvé de solution ? Pas grave, on aligne les millions et les milliards qui pleuvent, on se congratule du commerce extérieur forcément florissant, on expose des perspectives forcément riantes, et on triture des chiffres, comme cette moyenne de 4,4% du taux de croissance en 2021,22 et 23 exprimée par le chef du gouvernement, qui a fait une simple moyenne des taux des trois années précédentes, avec le yoyo de correction entre le taux de 2020 et celui de 2022. En faire une moyenne est une hérésie, mais M. Akhannouch n’en est plus à une hérésie comptable près…
Aziz Akhannouch et certains de ses ministres continuent de s’arcbouter sur des chiffres supposés instaurer la confiance mais constituant en réalité un déni de l’intelligence collective et du désespoir social. Alors que les indicateurs sont au rouge (confiance des ménages, faillites d’entreprises, effondrement du PIB agricole, envolée des prix des denrées alimentaires…), le chef du gouvernement et les siens persistent dans leur refus de voir les réalités ; les jeunes s’enfuient ou veulent s’en aller, même dans le « risque », les compétences s’exportent, les grèves se multiplient, le chômage avance, la croissance patauge, les agriculteurs crient à la misère, mais M. Akhannouch maintient le cap du « tout va pour le mieux dans le meilleur des pays ».
La question n’est donc pas de savoir si les problèmes sont solutionnables ou pas, mais si les responsables gouvernementaux et, plus généralement politiques, entendent le cri des populations ou non. La réponse est non. Faut-il s’inquiéter de ce déni ? la réponse est oui.
Aziz Boucetta