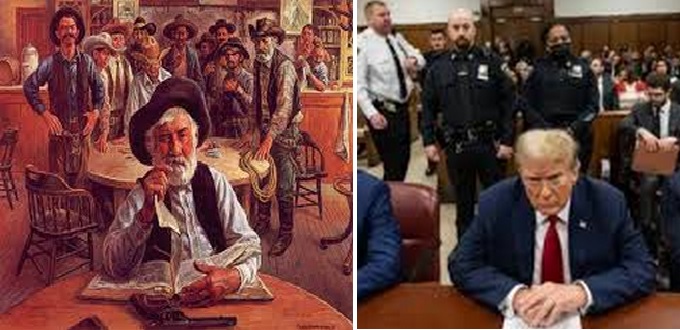(Billet 1118)- Désormais, s'il y a une grève générale au Maroc, personne ne s'en aperçoit...
Cette semaine dernière au Maroc, il y avait grève générale. Les centrales syndicales, mécontentes du débat qui a couvert l’adoption de la loi organique sur la grève, se sont senti flouées par le gouvernement et sa majorité et les grands chefs syndicaux ont appelé leurs troupes à observer un débrayage de deux jours. Le Maroc sera à l’arrêt, rien ne marchera et rien ne tournera, puisque secteurs public et privé étaient sommés d’arrêter le travail.
Les deux jours de grève étant passés, les 5 et 6 février, l’heure est au bilan. Pour les syndicats, la grève a été massivement suivie, avec des taux de 80%, tous secteurs confondus ; pour le gouvernement, et le ministère de l’Emploi plus particulièrement, les chiffres sont autrement plus faibles : 32 % dans le secteur public et 1,4 % dans le privé. Qui croire ? Personne sans doute, la réalité est quelque part entre les deux ordres de grandeur.
Mais la question à se poser est la suivante : Comment un monde syndical ne représentant en fourchette haute que 8% des salariés dans le pays peut-il réussir à faire débrayer environ 40% de ces travailleurs (il semblerait que le chiffre de 80% des syndicats soit quelque peu saugrenu) ? Comment ne pas penser à évaluer quelle partie des grévistes (il y en a eu tout de même) a débrayé plus pour goûter aux délices d’un ou deux jours de congé inespéré que pour une hypothétique adhésion à un grand dessein national ?
Et puis, une autre question, subsidiaire, peut être également soulevée : De quel monde syndical nous entretenons-nous alors que sur les trois grandes « centrales » syndicales, UMT, CDT et UGTM, la dernière ne fait non seulement pas grève, étant affiliée au parti de l’Istiqlal, mais a présidé la Chambre des conseillers trois années durant en la personne de son toujours secrétaire général Naâm Miyara ?
En France, l’ancien président Nicolas Sarkozy avait imprudemment dit un jour de 2008 que « désormais, quand il y a une grève en France, personne ne s'en aperçoit ». Et bien au Maroc, c’est le cas ! 10, 20, 30 ou même 125%, ces deux jours de la semaine dernière, personne dans le pays ne parlait, ne se préoccupait, ne s’inquiétait, voire même ne s’alarmait d’une grève générale. Une grève générale, au Maroc et ailleurs, mais surtout au Maroc, est synonyme de crise politique, de mouvements sociaux d’importance, d’insécurité en raison des troubles occasionnés par les piquets de grève et la police anti-piquets de grève ; ce n’était pas le cas cette fois-ci
Il faut dire que dans le monde actuel, celui de la finance et de la mondialisation, celui du capital et de la flexibilité, la voix syndicale n’est plus aussi audible. Et comme pour tous les secteurs, et dans tous les pays, la qualité du leadership s’érode et le syndicalisme se détricote. On est passé d’un syndicalisme incarné par des icônes, des personnages emblématiques, militants dans l’âme, ne craignant rien ni personne, vivant humblement… à des leaders en boutons de manchettes, aimant la vie et faisant ami-ami avec les puissants du moment, tout en jetant de temps à autre un œil furtif vers le haut puis un regard furibond sur le patronat. Des leaders inamovibles, généralement âgés, qui peinent à se faire entendre et encore plus comprendre par une population majoritairement jeune et à laquelle le syndicalisme ne parle pas ; à la place, comme pour les influenceurs qui surclassent les partis, les jeunes coordinations sont en passe de remplacer les vieux syndicats.
Pourquoi cette grève ? Si elle avait été envisagée au début du long processus de tractations conduit par le ministre Younes Sekkouri, quand même le CESE contestait la nature sécuritaire du projet de loi organique, quand des dispositions farfelues et effectivement liberticides y figuraient, on aurait peut-être compris… mais là, faire débrayer (ou du moins essayer), alors que le gouvernement a entériné l’écrasante partie des revendications salariales, on comprend moins. Interrogés, les chefs syndicaux, furieux, disent que le projet de loi, dans l’une et l’autre des Chambres, est passé à la hussarde, sans consensus. En fait de « hussarde », rappelons que la majorité est confortablement calée sur les deux tiers des députés et – les choses étant moins claires dans la Deuxième Chambre – un bon paquet de conseillers. La majorité numérique confortable, décriée par les syndicats, est on ne peut plus légale et légitime, et il faut rendre grâce au gouvernement (si, si !) d’avoir joué le jeu démocratique alors que, comme Abdelilah Benkirane en son temps, il aurait pu passer par le parlement et contourner les centrales.
Et ces syndicats de menacer, donc… Les syndicats, et en proue l’UMT et son patron l’inamovible Miloudi Moukharik, promettent des grèves pour les retraites, remettent en cause les tenues du Dialogue social qui, il est vrai, n’appartient pas aux préoccupations premières du chef du gouvernement Aziz Akhannouch. On se demande bien où M. Moukharik a puisé cette inspiration de tout bloquer, pour officiellement faire tout avancer ; peut-être faudrait-il y lire un signe politique, à l’approche des élections… sans doute que les idées et les inspirations respectent elles aussi les lois de la nature et de la gravitation, de haut en bas… il se pourrait, qui sait ?
Cette année, en tout état de cause, les syndicats fêteront leur 1er mai, dix ans après cette très étrange fête du Travail qu’ils avaient décidé de… boycotter ! Il est vrai que le chef du gouvernement était Abdelilah Benkirane, l’homme qu’on aimait tant détester chez les syndicats (et ailleurs), mais l’homme qui leur avait lancé un pastiche de Staline : « Les syndicats, combien de divisions ? ». Ce n’était assurément ni gentil ni délicat, mais c’était juste et pertinent.
Aujourd’hui, les centrales fulminent de colère et ruminent leur rage. Ils promettent de tout casser (enfin, façon de parler…), de tout arrêter, de tout rejeter, si cette loi sur la grève, dont la gestation n’a par ailleurs que trop duré, est maintenue. Alors même que le problème n’est plus là, mais dans le code du travail, le système des retraites, la nature et la force des entreprises, l’éthique du patronat et l’intelligence politique du gouvernement…
Et ça, c’est plus dur que convaincre des syndicats qui, de toutes les manières, ne pèsent plus grand-chose, voire sont volatils.
Aziz Boucetta