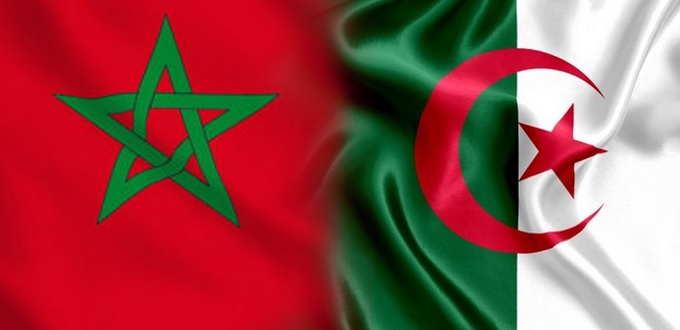“PARMI NOUS”, où quand le cinéma marocain pense au-delà du Maroc, par Youssef Boucetta
“Parmi Nous” de Sofia Alaoui est un récit centré sur une jeune fille, Itto, transfuge de classe par mariage, qui, séparée de sa belle famille, est livrée à une expérience transformatrice au milieu des plateaux de l’Atlas. Interprétée par Oumaima Barid, talent émergent du cinéma Marocain, Itto entraîne le spectateur dans un tunnel de questionnements existentiels, avec pour fond les paysages arides et expansifs de l’Atlas qui apparaissent comme un Far-ouest où se concentrent des mystères imperceptibles. Le pari thématique au centre du film : mettre en scène la rencontre entre l’alien et l’indigène dans un récit spirituel, sans exotiser ni l’un ni l’autre.
“Parmi Nous” s'ouvre sur des plans symétriques, soigneusement composés, d’une maison luxueuse de campagne. Il y a déjà là quelque chose de rare dans le cinéma marocain. La ruralité non pas comme ce qui est arriéré ou comme représentatif d’un manque, de la pauvreté. Ici, le milieu rural a une autonomie, avec ses riches et ses pauvres, ses exploiteurs et ses exploités.
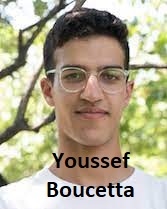 Dans ce début de film sont racontées les tensions intra-familiales qui esquissent la promesse d’une dissection des dynamiques de classe au Maroc. La mère vénale, Hajar (Souad Khouyi) débordant de “swabs”, aurait préféré que son fils (Mehdi Dehbi) se marie à une fassia et ne s’en cache pas. Le fils, peu sensible, ou volontairement sourd, à la guerre silencieuse à l’intérieur de la famille, ne voit dans sa femme qu’un corps, corps qui satisfait la pression sociale du mariage, corps qui peut porter un enfant, et corps à l’apparence acceptable. Il fait tout pour qu’elle se plie aux codes de sa famille, plutôt que de faire que la famille se plie à Itto.
Dans ce début de film sont racontées les tensions intra-familiales qui esquissent la promesse d’une dissection des dynamiques de classe au Maroc. La mère vénale, Hajar (Souad Khouyi) débordant de “swabs”, aurait préféré que son fils (Mehdi Dehbi) se marie à une fassia et ne s’en cache pas. Le fils, peu sensible, ou volontairement sourd, à la guerre silencieuse à l’intérieur de la famille, ne voit dans sa femme qu’un corps, corps qui satisfait la pression sociale du mariage, corps qui peut porter un enfant, et corps à l’apparence acceptable. Il fait tout pour qu’elle se plie aux codes de sa famille, plutôt que de faire que la famille se plie à Itto.
Ces rapports de force sont traduits par l’usage précis des langues, qui racontent la domination symbolique de ceux qui parlent français sur ceux qui parlent tamazight, avec pour seul intermédiaire la darija. D’un point de vue sociologique, la justesse de cette première partie du film suffit à élever sa trame, et à rendre multiple ses enjeux. Mais cela n’est pas la priorité du récit, ce n’est qu’une base structurelle à partir de laquelle se construit un autre édifice.
Lorsque la nouvelle famille d’Itto se rend à un engagement mondain chez le gouverneur de Khouribga, elle reste seule dans cette maison somptueuse, à l’esthétique baroque où se mélangent meubles rococo avec zelliges multicolores et salons traditionnels amples. Itto est, pour le temps d’un weekend, à nouveau indépendante.
Commencent alors à se glisser discrètement des éléments surnaturels, qui se manifestent principalement par le climat. Des teintures vertes à l’intérieur de masses de nuages rappellent le vocabulaire des films d’alien hollywoodiens. À travers la télévision et la radio, on comprend rapidement que l’état d’exception est mis en place en réponse à ce qui semble être une crise—la manifestation de phénomènes météorologiques qui suggèrent une présence vivante étrangère à la Terre. L’armée déploie des barrages et Itto, seule dans cette maison alors que le monde semble arriver à sa fin, décide d’aller rejoindre son mari à Khouribga.
Commence ainsi l’épopée au cœur du film—celle qui verra Itto traverser un désert illuminé par une présence extra-terrestre évasive, plus intrigante par son inintelligibilité qu’elle n’est menaçante. Alors qu’Itto se déplace à l’arrière d’un triporteur, elle parle avec une vieille dame qui relate que cette réaction publique - la présence des forces de l’ordre et la saturation des médias - n’a d’égal que la mort du précédent roi. Il n’en faudra pas long au spectateur pour comprendre qu’on assiste bien ici aussi à un changement de régime, mais cette fois-ci ce n’est pas la monarchie et son trône qui sont déstabilisés, c’est toute l’espèce humaine et ses croyances.
Dans les montagnes reculées, désertes du Haut-Atlas, des lumières verdâtres prennent une qualité solennelle et font de ces espaces vastes des sites d’intimité profonde. La pièce de consistance du film réside dans une séquence, placée précisément à sa moitié - un coup de cinéma d’un lyrisme tout aussi ambitieux que contrôlé. On perçoit dans cette séquence une correspondance entre le cinéma de Sofia Alaoui et la littérature de Borges. Leur geste est celui de la suggestion, suggérer le sublime, l’absolu, et contenir cette totalité ineffable dans le détail, dans l’objet singulier. Ils ouvrent une fenêtre, un cadre, à l’intérieur duquel se profilent les traces enivrantes d’une totalité irreprésentable. Un œil, un désert, une main, un livre, un mot—des microcosmes qui contiennent l’univers. Il s’agit d’imaginer et de ressentir, plutôt que d’être forcé à percevoir et comprendre. La rationalisation est brouillée au profit d’une volonté d'émerveiller le spectateur. Dans “Parmi Nous” cela ressemble à des fréquences d’image réduites, de l’imagerie
graphique, des superpositions de textures et de couleurs, ainsi qu’une bande sonore magistrale d’Amine Bouhafa pour distiller tout ce qu’il y a de plus poétique dans le (sur)naturel.
La dislocation de l’espace et du temps évoquée par ces procédés rend lisible une expérience spirituelle, à mi-chemin entre le psychédélique et le mystique. La présence extra-terrestre, éloignée d’un anthropomorphisme grossier, n’est pas un corps, mais plutôt l’ouverture sur un mode de conscience transcendant, la perte du repère de son propre corps, l’oblitération de la frontière conceptuelle entre l’humain et la nature. Comme Denis Villeneuve dans “Arrival” (“Premier contact”), Sofia Alaoui pense l'altérité radicale—à travers la présence extra-terrestre—non pas comme menace mais comme promesse. C’est précisément là où elle gagne son pari. Elle allie l’indigène, l’extra-terrestre, l’animal, et la transfuge de classe, et met en scène une solidarité alternative entre toutes ces figures qui représentent la marge, et cela avec une compassion qui se garde de tomber dans la naïveté.
À l’intérieur de ce traitement cinématographique de l’expérience spirituelle transcendante, se glisse une critique des usages corrompus de la religion quand elle sert à légitimer des rapports de force. Que faire quand le monde arrive à sa fin? Au Maroc, on prie. Les mosquées débordent alors de croyants qui cherchent le salut, dans la peur de l’inconnu absolu. Est-ce vraiment la solution? Pas quand cette même religion constitue une excuse pour maîtriser et commander les autres. Questionnant le dogme, le film s’attache implicitement à ce fameux “la ikraha fi dîn” (“nulle contrainte en religion”), et s’inscrit ainsi dans la lignée ouverte par Farida Benlyazid dans “Une porte sur le ciel”. Il s’agit dans les deux cas, comme dirait Walter Benjamin, de “tenter d’arracher la tradition au conformisme qui veut s’emparer d’elle.” (Thèse VI sur le concept d’histoire, 1940) La spiritualité organisée (la religion) est un élément traditionnel précieux à sauvegarder, mais elle doit être “arrachée” à ses politisations multiples, ses instrumentalisations, son impératif de conformisme qui assujettis les corps et les esprits.
À la différence de Benlyazid, Sofia Alaoui localise cette promesse non pas dans les cours intérieures d’un riad somptueux ou la théologie se négocie dans la bienveillance, mais dans les plateaux isolés de l’Atlas, où le spectacle du surnaturel aide à déconstruire les croyances prescrites, ou peut être à les ré-interpréter, les relire—dans un esprit réparateur plutôt qu’oppresseur. C’est la rencontre du personnage magnifiquement joué par Fouad Oughaou, qui ouvre la place à une nouvelle sensibilité pour Itto. Il guide Itto dans le désert, et l’accompagne jusqu’à ce qu’elle retrouve son mari à Khouribga.
Tous les éléments provenant de divers genres et les thèmes variés que Sofia Alaoui réunit dans ce cocktail l’aident à postuler la possibilité de faire un autre type de cinéma à partir du Maroc. Dans ce déplacement très intentionnel, elle s’éloigne du cinéma social et du réalisme qui caractérise les cinémas nationaux. C’est un film marocain mais ce n’est pas un film sur le Maroc. “Parmi Nous” parle intimement à une collectivité imaginaire qui dépasse nos régions géographiques et les limites symboliques de notre nation. Le Maroc n’est qu’une toile de fond pour une réflexion plus large.
Amenée par l’expérience spirituelle, la problématique de l’environnement est en réalité la plus grande question du film. En considération principale, l’idée que tout est animé par le même esprit, la même force vitale - que la variété du vivant, humain, animal ou végétal, n’est que la dispersion des attributs d’un seul être. Ainsi, la prise de conscience suggérée par le film est celle d’une réorganisation de notre rapport à la nature. Penser l’humain comme distinct de la nature (ce qui se fait le plus souvent) revient à le dire supérieur, car toute différence est productrice de hiérarchie. Sofia Alaoui suggère le contraire, penser l’humain comme constitutif de la nature, et ainsi chercher à redéfinir son rapport à l’environnement. C’est de cet esprit qu’est imprégnée la sensibilité de “Parmi Nous” et c’est ce même esprit qui en fait une contribution artistique pertinente, à un devoir de pensée sur l’humain et la nature qui, à l’heure de l’urgence climatique, ne connaît pas de frontières nationales.
Le film a reçu le Prix Spécial du Jury pour la Meilleure Vision Créative au Festival Sundance en Janvier 2023.
-------------------------------------
Youssef Boucetta est doctorant en littérature comparée à l’Université Northwestern, à Chicago. Il travaille sur la production littéraire, cinématographique, et artistique au Maroc depuis l’indépendance, la Darija et l’expression vernaculaire, ainsi que sur les cultures jeunes du monde arabe. Fils de diplomates, il a sillonné le monde et sa maîtrise de plusieurs langues lui a permis une ouverture culturelle, et artistique, sur le monde... qu'il met au service de la culture dans son pays.