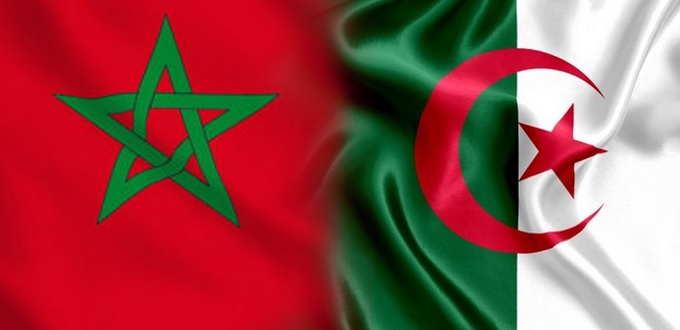Qualité de la croissance et réformes structurelles : critique d’une ritournelle, par Mohamed Soual et Rédouane Taouil

Le comportement de l’économie nationale est-il voué à rester mystérieux ?
En 2006, la Banque mondiale pointe dans son mémorandum consacré au Maroc une énigme : en dépit de la stabilité des prix, la limitation du déficit public et l’amorce de changements institutionnels majeurs, la croissance reste molle. Une décennie après, la même assertion est au cœur du diagnostic établi par l’organisation internationale de Washington : la progression du produit intérieur brut reste atone alors que la stabilité macroéconomique est largement assurée grâce à la conduite de la politique monétaire selon l’objectif de maîtrise de l’inflation et à la bonne gouvernance des finances publiques. Imputant cette atonie aux rigidités du marché du travail et au défaut de flexibilité sur le marché des produits et du crédit, la Banque mondiale prescrit des réformes structurelles censées renforcer les mécanismes concurrentiels et créer les conditions d’une plus grande efficacité à long terme. A force d’être exhibées comme étant de valence positive, de telles réformes échappent à l’interrogation. Or, à y regarder de près, elles reposent sur des présupposés fragiles.
L’assouplissement de la réglementation du marché du travail n’est pas de nature à accroître le potentiel de croissance ; à bien des égards, il risque de décourager l’innovation et de renforcer la déficience de la demande globale. Dans le même temps, l’impératif de libre concurrence ne semble pas à même de produire des gains d’efficience ainsi que le montrent la décompensation et le comportement du système bancaire.
Profil de la croissance et performances globales
La croissance de l’économie marocaine au XXIème siècle se caractérise par une croissance du produit intérieur brut molle, volatile, faiblement créatrice d’emplois et largement tributaire de l’agriculture. Telles sont les régularités empiriques que les rapports de la Banque mondiale mettent en avant à intervalles réguliers.
Le rythme de croissance annuelle moyen de la valeur ajoutée globale sur la période 2000-2015 se situe autour de 4,4%. Après une croissance moyenne annuelle 4,9 % entre 2000-2006 et de 4,3 %entre 2007-2012, l’activité connait un fléchissement en n’étant plus que de 3,8%. Cette évolution est marquée par une volatilité qui trouve son origine dans les fluctuations de la production agricole. Lorsque la croissance du PIB excède 3% c’est grâce à la bonne tenue des revenus du secteur agricole. La dépendance vis-à-vis de ce secteur va de pair avec la quasi-stagnation de la contribution de la valeur ajoutée des activités secondaires à la production globale.
Dans ce contexte, l’économie nationale connait un chômage de masse persistant à forte proportion de jeunes. Si le taux de chômage est en moyenne de l’ordre de 9 à 10%, le taux d’emploi, qui désigne la part de la population active occupée dans la population en âge d’activité, est à peine égal à 44,8%. De telles performances apparaissent sibyllines malgré la vigoureuse hausse du taux d’investissement durant les années 2000 : celui-ci atteint 32%, soit un niveau proche de celui d’économies comme la Chine ou la Corée du Sud pendant que la croissance reste de moitié inférieure à celle qui a assuré l’émergence de ces économies.
Le credo de ce diagnostic, qui établit que le faible impact de l’accumulation du capital physique vient renforcer l’énigme de la croissance, est que l’économie nationale pâtit de l’insuffisance des actions sur le degré de concurrence sur les marchés et sur la productivité globale des facteurs de production : « il faut parvenir -déclare en substance l’économiste principal pour le Maroc de la Banque mondiale, Jean-Pierre Chauffour- à créer les conditions favorables à la flexibilité sur l’ensemble des marchés et opérer les transformations structurelles qui sont relativement lentes »
L’idée de base de cette recommandation maîtresse est que la fonction éminente du marché consiste à garantir une allocation efficiente des ressources et un équilibre de plein emploi. Les autorités publiques doivent mettre en œuvre des réformes de structures destinées à libérer les marchés des produits, du travail et du crédit des entraves réglementaires, à renforcer la flexibilité et à élever le taux de la croissance potentielle. Ces politiques structurelles, qui procèdent d’une vision normative selon laquelle la concurrence parfaite est le mode de fonctionnement idéal des marchés, doivent soutenir les politiques de maîtrise d’inflation et du déficit public chargées de la promotion de la stabilité macroéconomique.
Les rapports de la Banque mondiale sur le Maroc font l’objet, l’argument d’autorité aidant, d’une large réception favorable. Quand ils établissent un diagnostic positif, le décideur public les reprend à son compte pour brandir, dans des déclarations répétées à satiété, une caution en faveur de la politique économique. Lorsqu’ils émettent des réserves, celles-ci sont tenues pour argent comptant par une opinion médiatique en quête de critiques à l’endroit des autorités gouvernementales. Au regard de cette influence sur le débat public, l’hypothèse de l’énigme de la croissance, séduisante à maints égards, appelle une critique en mesure de montrer les contradictions internes de ses soubassements et préceptes.
L’équivoque de la réforme du marché du travail
L’instauration de la flexibilité du marché du travail est mise en avant comme une réforme à même d’élargir les opportunités d’emploi de croissance. Or, à en questionner les enjeux, il apparaît qu’elle ne possède pas les vertus qui lui sont conférées. La limitation des contrats à durée indéterminée, le développement prioritaire des contrats temporaires, la réduction de la protection de l’emploi comme la variabilité des salaires, ne sont en mesure ni de développer les incitations à innover, ni de stimuler l’activité et l’emploi. Ainsi que le montre l’enquête nationale du HCP, la flexibilité est le lot d’une large fraction des salariés :
- L’emploi de plus de 65% des salariés n’est pas régi par un contrat de travail. Ainsi, dans les branches comme l’agriculture ou les BTP, à peine 10% est employé sous contrat ;
- Plus de 80% de la population active occupée est exclue du système de protection sociale (retraite et couverture maladie) ;
- L’emploi non rémunéré représente 23% de l’emploi au niveau national et 42% en milieu rural ;
- Près de 8% du volume global de l’emploi est occasionnel ou saisonnier.
Cette flexibilité de fait conduit à une trappe à bas salaires dont le corolaire est un faible niveau de productivité. En effet, la relation salariale se caractérise dans nombre d’entreprises par un double aléa moral. D’un côté, les entreprises enfreignent les réglementations en matière de conditions de travail et de rémunération. De l’autre, les salariés ne fournissent pas l’effort productif adéquat. Peu incitatif, le niveau des salaires place l’économie dans des conditions caractérisées par l’existence de gains inexploités pour les deux parties.
En étendant les facilités de licenciement, la flexibilité risque de renforcer les facteurs de basse productivité à travers le recours à des contrats de courte durée. Ces contrats conduisent les entreprises à investir moins dans les compétences spécifiques des travailleurs et à préférer le licenciement à l’amélioration de la productivité. Ainsi, se trouvent découragés l’apprentissage par la pratique et la mise en place d’innovations. La trappe à bas salaires se double ainsi d’une trappe de sous-qualification.
Le handicap majeur de certaines entreprises exportatrices tient à l’insuffisance de capacités d’offre adaptées à la demande externe. Cette inadaptation résulte de stratégies routinières. L’option en faveur de la compétitivité-prix au détriment de la compétitivité structurelle entrave le redéploiement de l’appareil productif vers des productions favorisant la montée en gamme et les produits à plus forte valeur ajoutée.
Outre cet impact, la flexibilité du marché exerce des effets restrictifs sur la demande globale et, par conséquent, sur l’emploi. Si elle offre des opportunités d’ajustement aux entreprises, elle soumet l’emploi et la demande aux fluctuations de la conjoncture, maintient la faiblesse des débouchés des entreprises et bride l’incitation à investir. En l’absence de politiques monétaire et budgétaire réactives à même d’amortir ces fluctuations, la flexibilité du marché du travail présente le risque d’aggraver à la fois la volatilité de l’activité et l’insuffisance de la demande d’origine domestique consécutive à l’accentuation des inégalités, au niveau d’emploi et à l’égalisation des salaires par le bas.
La réforme du marché du travail est susceptible de renforcer la précarité et la pauvreté structurelle qui résulte de l’insatisfaction des nécessités de base. De telles conditions ne sont pas en mesure d’assurer l’employabilité en ce qu’elles entravent la construction des ressources individuelles : la chute du revenu en cas de chômage décourage les dépenses d’éducation et de formation et prolonge le chômage de longue durée. Les incitations à la formation risquent d’être contrebalancées par le découragement induit par la désaffection consécutive à la perte d’emploi et le coût correspondant.
Au total, la déréglementation du travail risque de reproduire sur une large échelle le triangle de fer caractéristique de la croissance molle. : faible productivité, basse rémunération, et chômage de masse. Le propos lapidaire de la présidente de la CGEM « on ne bâtit pas une économie pérenne avec de bas salaires » a ici toute signification.
La libre concurrence génère-t-elle des gains d’efficience ?
La Banque mondiale n’a eu cesse de plaider en faveur du démantèlement du système de compensation auquel elle attribue trois inconvénients à savoir : l'inefficience due aux subventions de produits de base et aux obstacles à la concurrence qui se traduisent par des situations de rente, le défaut d’équité liée au fait que ces subventions profitent plus aux catégories riches qu'aux démunis, et l'alourdissement des charges budgétaires qui pèse sur la stabilité macroéconomique. Si ce diagnostic est juste, il mérite qu’on s’attarde sur les conséquences de son démantèlement sans filets de sécurité.
 Reprenant terme à terme cette argumentation, le décideur public a lancé un programme de décompensation en supprimant le contrôle des prix des produits pétroliers. Après le retrait des subventions, la fixation des prix est devenue l’objet des décisions libres des entreprises de distribution. A examiner l’impact de cette mesure, on s’aperçoit qu’elle n’a augmenté ni l’intensité de la croissance, ni amélioré l’efficience. D’abord, les entreprises, qui étaient en position dominante dans le cadre du système des subventions, ont renforcé leur pouvoir de marché et ce d’autant que l’organisation de leurs réseaux de distribution les y aide fortement.
Reprenant terme à terme cette argumentation, le décideur public a lancé un programme de décompensation en supprimant le contrôle des prix des produits pétroliers. Après le retrait des subventions, la fixation des prix est devenue l’objet des décisions libres des entreprises de distribution. A examiner l’impact de cette mesure, on s’aperçoit qu’elle n’a augmenté ni l’intensité de la croissance, ni amélioré l’efficience. D’abord, les entreprises, qui étaient en position dominante dans le cadre du système des subventions, ont renforcé leur pouvoir de marché et ce d’autant que l’organisation de leurs réseaux de distribution les y aide fortement.
La suppression de ce système leur donne ainsi l’avantage de fixer les prix et les marges selon leur convenance. Aussi, elles sont enclines à adopter des comportements asymétriques en répercutant les hausses des prix et non les baisses. Dans ce contexte, le passage d’une offre administrée à une offre censée être concurrentielle ne bénéficie pas au consommateur. Ensuite, la décompensation s’est traduite par la pratique d’une marge libre en lieu et place de la marge de structure qui comprenait, outre une fraction fixe (taxe, coût de stockage, élément de marge…), une fraction proportionnelle à la cotation du produit sur le marché international.
Cette pratique a conduit à un gonflement des rentes. Des calculs des deux marges mettent en évidence un écart d’une moyenne de 116 dollars la tonne. La marge libre a enregistré une hausse d’à peu près 25% qui correspond à un surcroît de 14% par rapport à la cotation de base. Enfin, la suppression de la subvention des carburants ne s’est pas accompagnée d’une montée de l’inflation : le rythme de variation de l’indice des prix à la consommation est resté inférieur à 2%. Il ne s’agit pas là, cependant, d’une conséquence de la réforme du système de compensation, mais manifestement d’un effet d’aubaine consécutif à la baisse prolongée des cours des produits pétroliers sur le marché mondial. S’il y avait eu renchérissement de la facture pétrolière et alimentaire, on ne saurait à coup sûr pu bénéficier d’une telle évolution en l’absence de compensation. Les subventions des produits de base constituent un puissant facteur de maîtrise de l'inflation importée. Elles participent à la fois à l’atténuation du niveau de l’inflation globale et à la réduction de sa volatilité en évitant de faire subir à l'économie nationale les fluctuations des cours mondiaux.
Si l’on envisage le scénario d’une hausse des produits pétroliers et alimentaire dans un contexte scénario de la décompensation, la probabilité d’un relâchement de la maîtrise de l’inflation n’est pas à écarter. Une montée de l’inflation est de nature à engendrer une instabilité économique accompagnée d’un recul prononcé de l’activité et d’une montée du chômage. D’une part, la dégradation de la compétitivité-coût des produits à l’exportation, dans un contexte mondial caractérisé par une forte modération de l’inflation, est susceptible de détériorer la demande extérieure et de creuser le déficit de la balance commerciale. D’autre part, en l’absence de dispositifs de soutien de la demande,la réduction du pouvoir d’achat risque de peser fortement sur la demande domestique.
 Si la Banque centrale engage, conformément à ses statuts, une politique de désinflation, elle sera amenée à procéder à un resserrement de la création monétaire. Une telle mesure restrictive entraîne inéluctablement une contraction de l’offre du crédit bancaire qui vient décourager la production et les dépenses d’investissement et de consommation aggravant ainsi l’impact négatif consécutif à l’affaissement de la demande globale. Les ajustements budgétaires qu’implique la décompensation, ne peuvent qu’accentuer cet affaissement et installer l’économie marocaine sur un sentier de récession. De ce point de vue la réforme du marché des produits apparaît incohérente avec l’objectif de stabilité assigné aux politiques monétaire et budgétaire.
Si la Banque centrale engage, conformément à ses statuts, une politique de désinflation, elle sera amenée à procéder à un resserrement de la création monétaire. Une telle mesure restrictive entraîne inéluctablement une contraction de l’offre du crédit bancaire qui vient décourager la production et les dépenses d’investissement et de consommation aggravant ainsi l’impact négatif consécutif à l’affaissement de la demande globale. Les ajustements budgétaires qu’implique la décompensation, ne peuvent qu’accentuer cet affaissement et installer l’économie marocaine sur un sentier de récession. De ce point de vue la réforme du marché des produits apparaît incohérente avec l’objectif de stabilité assigné aux politiques monétaire et budgétaire.
Dans son plaidoyer en faveur des réformes structurelles, la Banque mondiale n’omet pas d’évoquer la nécessaire flexibilité sur le marché du crédit. Elle le fait cependant discrètement car les imperfections de ce marché ne sont pas le produit de réglementations qui viennent biaiser le choix des agents. La libéralisation du secteur bancaire, initiée depuis bientôt trois décennies a débouché sur la formation de comportements oligopolistiques dont l’effet est l’inexistence d’inefficacités qui affectent le profil de l’offre de crédit et, par conséquent, l’activité. Selon une enquête récente sur les obstacles à l’investissement, 80% des entreprises estiment que leur développement est contraint par les conditions en matière de garanties et le coût élevé du financement bancaire. Ces garanties qui sont tenues par les banques pour un signal de qualité leur permettant de discriminer entre les emprunteurs conduisent à l’éviction de nombreux candidats au crédit. Jointes aux primes des risques, elles entraînent une différenciation de l’accès aux prêts bancaires qui se manifeste dans l’existence d’un marché du crédit structuré en deux segments : d’un côté, de grandes entreprises bénéficiant de conditions avantageuses en termes de collatéraux et de frais financiers ; de l’autre, des petites et moyennes entreprises soumises à des taux d’intérêt et des garanties souvent rédhibitoires.
En dépit de l’existence de moyens alternatifs de financements (fonds d’investissement et divers instruments du marché de capitaux), ces rationnements financiers entraînent une insuffisance de l’offre effective du fait de l’impossibilité pour les entreprises, de produire la quantité désirée ou mener à bien leurs projets. D’autre part, loin d’assurer des taux d’intérêt favorable à une meilleure allocation des ressources, la réforme du marché du crédit a conduit à une concurrence restreinte qui se manifeste dans des comportements oligopolistiques en matière de fixation des taux débiteurs et des critères de garanties et partant dans des rigidités à la baisse du coût de financement. Les réactions des banques au réglage monétaire sont en effet asymétriques. En cas de restrictions, les banques relèvent le taux débiteurs et restreignent leurs prêts en accentuant leurs exigences en matière de nantissement. En revanche, lorsque la Banque centrale assouplit les conditions de refinancement, elles répercutent faiblement ce desserrement entravant par-là la transmission des impulsions monétaires favorables à la stimulation de l’activité. Ces effets contrastent avec ceux attendus de la modification des institutions du marché du crédit suite au déplafonnement des taux d’intérêt, à la suppression de l’encadrement des prêts et à l’allégement de la réglementation des dépôts.
Au total, les réformes structurelles ne semblent pas constituer une solution à l’équation de la croissance, de l’emploi et du bien-être : outre qu’elles ne créent pas les conditions favorables à l’innovation, à l’élévation de la productivité et du potentiel d’offre, elles renforcent les facteurs restrictifs de la demande d’amplification des fluctuations de l’activité. De par le renforcement de la trappe de sous-qualification, la flexibilité du marché du travail s’oppose à l’innovation. La réforme du marché des produits à travers la décompensation des produits pétroliers n’a pas, grâce au bas niveau des cours internationaux, induit un surcroît d’inflation, mais elle profite largement aux offreurs vu l’écart entre les prix pratiqués et les prix indexés sur ces cours.
Dans le contexte d’un retournement sur le marché mondial et faute de mécanisme de soutien ciblé à la demande, il est hautement probable que la décompensation entraine une montée de l’inflation et remette en cause la stabilité macroéconomique contrariant ainsi l’objectif de maîtrise de l’évolution des prix de la Banque centrale. Mise en œuvre en vue d’améliorer l’efficacité du système bancaire par la baisse des coûts d’intermédiation et accroitre les opportunités de financement externe des entreprises, la réforme du marché du crédit ne semble guère favoriser la transmission de la politique monétaire et participer à une dynamique vertueuse de l’investissement.
Ces réformes, dont la Banque mondiale est un promoteur majeur, ont un impact certain sur les ressources et le bien-être des citoyens et partant sur l’exercice des droits citoyens et démocratiques. Elles doivent, par conséquent, faire l’objet d’un débat d’idées. Car les analyses de l’institution de Washington influent fortement l’horizon de la pensée sur le développement et les politiques publiques. Comme l’écrit Keynes « Ce sont les idées (…) qui sont dangereuses pour le bien et pour le mal ».
Mohamed Soual et Rédouane Taouil, économistes