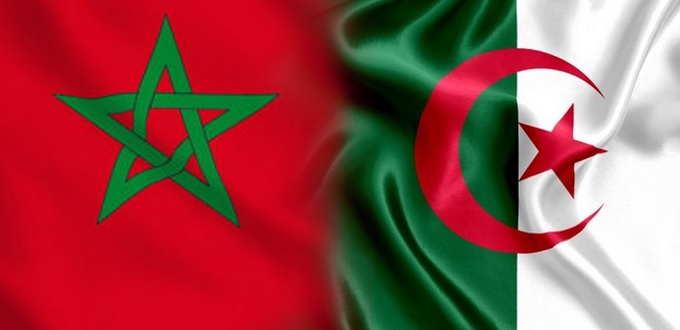Une solution serait, peut-être, un amendement à la constitution, par Aziz Boucetta
- --
- 09 octobre 2018 --
- Opinions
Le Maroc vit aujourd’hui, et de l’avis quasi unanime, une crise. Et cette crise est inédite dans l’histoire récente du pays, ressemblant en quelque sorte à l’impossibilité du royaume à franchir un seuil. L’atonie est économique, le malaise est social, mais la crise est politique, et elle est à l’origine de l’atonie et du malaise. Il faut alors chercher une solution du côté de la constitution, sans doute belle dans ses intentions, mais affligée d’un personnel politique rebelle à toute innovation.
La crise est politique au Maroc.
Depuis 2011, la scène politique au Maroc est non seulement rythmée par la violence verbale, mais aussi, surtout, et de plus en plus, par le rejet, voire la haine. Loin d’être tirés vers le haut par la nouvelle constitution, nos politiques n’en finissent pas de plonger, et de s’accrocher. Ils tergiversent, hésitent, se consultent, s’insultent… et au final, ne font rien. La raison ? une architecture institutionnelle inadaptée à notre réalité et à notre histoire.
Cela favorise l’installation durable d’un sentiment d’injustice, d’une perception de pauvreté et de la peur de la précarisation, empêchant toute action sérieuse. Or, le Maroc, politiquement stable, est potentiellement riche. Pour le devenir réellement, ceux qui peuvent doivent répondre aux attentes de ceux qui attendent, ou partir.
Notre modèle d’inspiration politique est désormais dépassé, car inadapté.
Notre architecture institutionnelle est en quelque sorte calquée sur le modèle de gouvernance occidentale. Mais ce modèle est lui-même en souffrance, essoufflé par les nouveaux défis économiques et sécuritaires, suffocant sous les coups des droites extrêmes, et soumis à la dictature masquée du capital roi (lire « le prix de la démocratie », Julia Cagé, Fayard) qui retire toute substance à l’idée même de démocratie. Le modèle post-occidental peut alors naître et apparaître.
 La conséquence de cette désoccidentalisation institutionnelle est le basculement de plus en plus d’Etats vers des systèmes autoritaires où le capital est mieux canalisé, la prédation plus maîtrisée et où la rentabilité et l’efficience économiques sont érigées en objectifs d’Etat. Aujourd’hui, Chine, Singapour ou encore Corée du Sud constituent une alternative à une démocratie occidentale à la peine, comme on le voit en France, aux Etats-Unis, en Espagne, en Italie… En un mot, l’idée démocratique prend le pas sur la pratique démocratique : les élections sont là, les corps élus aussi, mais seul le système institutionnel prime, car responsable ultime du développement.
La conséquence de cette désoccidentalisation institutionnelle est le basculement de plus en plus d’Etats vers des systèmes autoritaires où le capital est mieux canalisé, la prédation plus maîtrisée et où la rentabilité et l’efficience économiques sont érigées en objectifs d’Etat. Aujourd’hui, Chine, Singapour ou encore Corée du Sud constituent une alternative à une démocratie occidentale à la peine, comme on le voit en France, aux Etats-Unis, en Espagne, en Italie… En un mot, l’idée démocratique prend le pas sur la pratique démocratique : les élections sont là, les corps élus aussi, mais seul le système institutionnel prime, car responsable ultime du développement.
Le makhzen politique.
Tantôt décrié, parfois raillé, souvent critiqué, toujours reconnu, admiré et craint, ce symbole porté par la monarchie a traversé les siècles, et demeure encore aujourd’hui dans tout son faste et son prestige. Sa force réside dans sa grande capacité d’adaptation. En 2011, dernière adaptation en date, le roi Mohammed VI avait initié une constitution « révolutionnaire », mais on ne peut faire du neuf avec du vieux, car si notre classe politique se renouvelle dans la forme et les figures, les états d’esprit demeurent, et donc les entraves à l’action aussi.
Ce cadre institutionnel, légitime et fort, que cherchent aujourd’hui les Etats, tous les Etats, le Maroc l’abrite depuis plus de mille ans. Au vu de la personnalité du roi et des acquis engrangés depuis 20 ans, en plus des mutations politiques internationales et sociologies internes, la solution à nos blocages politiques pourrait (finalement) venir de ce makhzen.
Une réforme politique.
Le Maroc a davantage besoin de prospérité, de vision prospective, de soins et d’éducation, que d’institutions bétonnées, importées sans être forcément adaptées, astreignantes et donc contre-productives. Ce postulat étant posé, il apparaît qu’une réforme constitutionnelle s’impose, et tout particulièrement concernant l’article 47 qui s’est montré, sept ans après, handicapant.
A devoir
obligatoirement choisir « le Chef du Gouvernement au sein du parti politique arrivé en tête des élections législatives », comme le dispose cet article, nous n’avons eu le choix finalement, avec un PJD « arrivé en tête », qu’entre un Abdelilah Benkirane trop clivant et un Saadeddine Elotmani trop conciliant. En dehors d’eux, au PJD, personne. Il en va de même dans les autres partis. Or, le choix du n°2 du royaume doit pouvoir être large, pour gagner en efficacité.
Osons le dire : un chef du gouvernement obligatoirement chef (ou sous-chef) d’un parti, c’est bien pour l’orthodoxie démocratique telle qu’on la connaît et qu’on se la dépeint, mais ça l’est moins pour l’efficience économique. Or, l’économie est tout. Pour que le pays fonctionne, et sorte de cet attentisme ravageur, il est impératif que le chef du gouvernement soit choisi non en fonction de ses appartenances partisanes et/ou idéologiques mais sur la base de ses aptitudes managériales et de ses compétences en économie.
Aussi, amender, en le simplifiant, l’article 47, donnerait plus de choix au chef de l’Etat pour choisir son chef du gouvernement, alliant ainsi la nécessité de respect de la constitution avec celle des impératifs de croissance et de développement. Mais comment amender un article sans nécessairement passer par la (lourde) voie référendaire ? La constitution offre cette possibilité, dans son article 174 : « Le Roi peut, après avoir consulté le Président de la Cour constitutionnelle, soumettre par dahir au Parlement un projet de révision de certaines dispositions de la Constitution. Le Parlement, convoqué par le Roi en Chambres réunies, l’approuve à la majorité des deux tiers des membres du Parlement ».
Un chef de gouvernement, c’est bien, mais un chef de gouvernement efficace, c’est encore mieux. Notre classe politique n’en offre pas, aujourd’hui, il faut en convenir. Alors pourquoi se lier les mains et perdre du temps, et de l’argent ?...
L’objectif politique.
Il est de procurer au Maroc un gouvernement cohérent et efficace, sous la conduite d’un homme, ou d’une femme, doté(e) de larges aptitudes de commandement et de connaissances aussi larges en économie, en gestion publique, en esprit entrepreneurial. Trois choix s’offrent alors à ce personnage, qui pourrait être partisan, ou non :
1/ Regrouper une majorité, former son gouvernement et se présenter devant le parlement pour obtenir l’investiture. La logique démocratique sera ainsi respectée, et le législatif se scindera naturellement en majorité et en opposition.
2/ Mobiliser l’ensemble de forces politiques en présence pour former un gouvernement d’union nationale resserré autour de grands pôles, économique, social, technique et politique. Le Maroc pourrait innover avec, une fois n’est pas coutume, une quinzaine de ministres.
3/ Former un gouvernement de technocrates qui, pour obtenir son investiture, serait appelé à désigner des ministres d’Etat qui seraient les chefs des 5 ou 6 premiers partis lesquels élaboreraient avec leur chef du gouvernement une plateforme politique triennale ou quinquennale, avant de basculer sur l’une ou l’autre des deux premières options.
Dans les trois cas, ce personnel politique devra être réellement, totalement et absolument assujetti au principe de reddition des comptes, face à une justice élue…
Régression politique ?
Non, cela ne serait pas un retour en arrière en démocratie, car ajuster un dispositif constitutionnel n’est pas reculer, et l’adapter aux réalités socio-politiques n’est pas renoncer à la démocratie. Et il existe deux garde-fous, le premier étant l’article 175 de la constitution qui interdit tout renoncement aux choix démocratiques et le second étant l’inclinaison démocrate du chef de l’Etat.
Le Maroc politique ne fonctionne pas aujourd'hui, et induit une léthargie économique et donc un malaise social. Alléger certains articles d'une constitution n’est certes pas une panacée, mais certainement un début de solution.